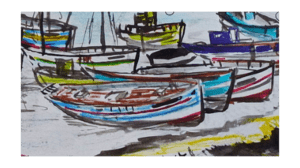Les bélougas dans la baie de Concarneau
Pendant les années d’occupation de Trégunc par l’armée allemande, le requin-pèlerin était le bienvenu dans la baie de Concarneau. Par ces temps de disette, sa pêche a nourri une partie de la population.

En revanche, signalé sur nos côtes à plusieurs périodes, le bélouga ou béluga, ainsi nommé par les marins bretons à cause probablement d’une ressemblance avec le véritable béluga1, n’était pas vraiment apprécié par les professionnels de la pêche. Selon François de Beaulieu il s’agissait peut-être du dauphin de Risso ( photo ci-dessus: Michael L. Baird).
Le dauphin de Risso est un cétacé au ventre de couleur claire et au dos gris, mammifère d’une longueur de trois à quatre mètres, il ne porte aucune dent apparente à la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure en possède quatorze au maximum (elles peuvent disparaître chez les individus âgés). Il se nourrit essentiellement de calamars, mais peut occasionnellement manger certains poissons. Comme la sardine ! ce dont était accusé l’animal par les marins-pêcheurs quand ils retrouvaient leurs filets déchirés.
Chassant en groupes d’une dizaine de spécimens, les soi-disant bélougas se plaisent dans les zones de pêche à la sardine. Les femmes de marins, ménagères, cultivatrices et parfois ramendeuses sont très en colère lorsqu’elles doivent réparer les grandes ouvertures faites dans les filets à sardines.
Selon les souvenirs de nos anciens marins, la présence des bélougas est constatée dans les années 1820 à 1840, puis de 1880 à 1890. Les journaux locaux signalent également le cétacé dans la baie en 1919 et en 1946.
En mai 1919, le député de Quimper, monsieur Bouilloux-Laffont, est sollicité par les marins du quartier maritime de Concarneau afin d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur la présence des bélougas dans la baie. Le 16 avril, il adresse un courrier circonstancié à la marine marchande et à monsieur Bouisson, commissaire aux transports maritimes ; ce dernier lui répond le 26 avril en précisant qu’il est intervenu auprès de Georges Leygues, ministre de la Marine. Aussitôt, le préfet maritime de Brest fait intervenir les torpilleurs de la Marine nationale, à leurs bords des fusiliers marins prêts à en découdre avec ces animaux sauvages. Des explosifs ont également été utilisés afin de les éloigner des bancs de poissons.
En août 1946, les pêcheurs de Clohars-Carnoët demandent l’intervention d’avions équipés de mitraillettes pour chasser ces bélougas des zones de pêche de la sardine et du maquereau.
Au mois de juin 1946, les enfants de Trégunc se baignent à Pouldohan. Robert Sellin avait 16 ans à l’époque, il nous a plusieurs fois raconté qu’il nageait jusqu’au banc de bélougas, lesquels jouaient entre la plage de Cabellou et celle de Pouldohan ; mais il n’y avait pas suffisamment de sardines pour boucher le port de Pouldohan !
Le professeur René Legendre (1859-1954), directeur du laboratoire de biologie marine de la Croix à Concarneau, disait : le bélouga était un sujet de mécontentement. René Legendre a mis au point une nouvelle rogue, moins coûteuse, pour pêcher la sardine et une rue, face au port de Concarneau, porte son nom.
Ces animaux marins ont quitté nos côtes depuis les années 1950, probablement à cause de la disparition des bancs de sardines, maquereaux et harengs du proche littoral.
Notes
1 Le béluga, cétacé entièrement blanc qui vit dans les eaux froides de l’océan Arctique ou encore dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent mesure 4 à 5 m de long
Sources
– Article de François de Baulieu de Bretagne Vivante
– Articles du journal Le Finistère du 5 et 17 mai 1919
– Article du Ouest-France du 23 août 1946
– Les matelots de Concarneau par Pierre Le Maître et Michel Guéguen