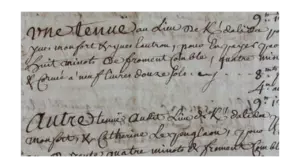Trégunc autrefois

La voie de Trégunc à Concarneau n’était jusqu’à la Révolution qu’une route de campagne améliorée pour permettre le passage des charrettes de paysans et les calèches des gens aisés. Elle était entretenue par les « corvées » de Trégunc jusqu’à la borne de Douric ar Zin, celles de Lanriec finissaient au Passage. Le pouvoir républicain décidera d’en faire la Route Départementale n°1 de Quimperlé à Concarneau.
À Trégunc, on dit Hent Conq en breton et Grand Route en français, et pas Grande Route, depuis sa percée vers 1840 depuis le haut du Bourg à travers les terrains de Kerantalec, c‘est une belle voie d’onze mètres de large, les charrettes peuvent s’y croiser.
À Beg Keroul, elle passe devant la Pierre tremblante, Men Dogan, la Pierre des Cocus, puis devant un dolmen naturel cent mètres plus loin.

Elle traverse Kermao et file vers l’anse de Veil Vour où l’on a construit sur remblai, à cent mètres en aval, un nouveau Pont Minaouët pour arriver directement à Kerviniou. C’est un gain de temps sur la route de Concarneau, on évite le vieux pont, étroit et malaisé.
À travers le Porzou, Kerancalvez et le Manoir du Bois, une route du Passage au Pont du Moros passe l’anse du Roudouic sur un remblai et rejoint la route de Lanriec.
Trégunc a été le grand bénéficiaire de la construction de ce Pont du Moros qui lui donne enfin un accès direct à la ville importante qu’est devenue Concarneau, évitant le bac du Passage qui continue à servir aux ouvrières d’usine de Trégunc, Lanriec et le Passage. Les charrettes et les chars à bancs des paysans gagnant un temps précieux peuvent livrer directement leurs clients de Concarneau, moyennant un modique péage.
Pendant quelques années, de 1908 à 1937, le luxe pour se déplacer vers Concarneau ou Quimperlé était le chemin de fer. Depuis 1903, fonctionnait une ligne allant de Quimperlé à Pont-Aven. Les communes de Nizon, Névez, Trégunc et Lanriec avaient fini, non sans mal, par obtenir du Conseil général, en août 1901, son prolongement jusqu‘à Concarneau. Le nouveau tronçon sera mis en service en 1908 : ce sera le petit train de Quimperlé à Concarneau.
La déclaration d’utilité publique va entraîner l’expropriation d’une bande de terrain des fermes des oncles Youn et François, carrément coupées en deux. C’est un gros inconvénient pour le travail des fermes et les déplacements des animaux que les trains effraient, d’autant qu‘il n‘y a pas de passages à niveau. La ligne traversait les terres de la ferme du bourg et celles de Kerangallou, passait à ras de nos champs de Keroul, ceux de Coat Min, traversait le Minaouët sur un petit pont entre Meil Mao et Meil Coat-Min, filait sur Lanriec, passait Toulmengleuz et arrivait à la petite gare de Concarneau au bout du quai aux engrais, futur quai Carnot.

La gare de Trégunc se trouvait au bord de la route de Melgven, à proximité de chez Corentin Dé, sur un terrain de la ferme Cariou. La ligne du petit train a été mise en service à l’été 1908. Je n’ai pas souvenir du marc’h du supprimé en 1936, victime de la concurrence des camions et des cars. J’ai seulement gardé celui de la Micheline jaune et rouge qui me faisait si peur lorsque je la voyais passer quand je me promenais sur le bas-côté tenant la main de Ninie, la fille de Marjann n‘hent Couz, qui m’obligeait à sauter dans le fossé.
La petite gare de Concarneau ne reçoit plus de trains depuis 1937. Venant de Quimper et de Quimperlé via Trégunc, ce sont les cars rouges de la Satos et les verts de la Régie aux horaires réguliers qui les ont remplacés.

Les cars d’Auguste Naour partaient de Port Manec’h, passaient par Névez, s’arrêtaient devant chez Hingant, en haut de la rue de Concarneau, et poussaient jusqu’à Concarneau ; il suffisait de faire signe aux conducteurs pour qu’ils s’arrêtent. Louis Cras, avec son vieux Berliet, partait de chez Yvon Marrec, faisait du cabotage sur le trajet Concarneau-Trégunc-Trévignon et surtout du transport pour les ouvrières d‘usine appelées au boulot.
Les paysans avaient presque tous un char à bancs, il y en avait des quantités le dimanche ou les jours de foire, les chevaux étaient attachés aux anneaux fixés un peu partout sur les murs des maisons de commerce. Il n’y avait plus qu’à ramasser le crottin qui jonchait la route et qui servait aux jardiniers amateurs à fumer leurs cultures de légumes.
Les familles de Calan et de Malherbe se déplaçaient en calèche. Je revois encore, tirée par ses mules, celle de Pierre de Malherbe, avec sa femme Marie Léontine Prouhet et ses petits-enfants de la Touche et Laboria, montant péniblement la vieille route, pour aller occuper à l’église la stalle à gauche de la nef, celle de droite étant réservée aux de Calan. Les Malherbe arrivaient toujours en retard. Madame, en grande tenue, portait toujours des chapeaux ornés de colifichets, comme des oiseaux. D’abord appelée la Grande Bergère, parce que très distinguée, elle était devenue Grands Zoizeaux pour les gens de Trégunc toujours prompts à attribuer des surnoms.
Les ouvriers d’usine, qui avaient la chance de posséder une bicyclette aux pneus ballon ou demi-ballon en fonction de la grosseur, allaient tous les jours au travail à Concarneau par ce moyen ; ça prenait du temps sur ces routes sommaires, mais on économisait le prix du billet de car. Les marins étaient presque tous équipés de bicyclettes, parfois les misainiers de Pouldu ou de Porsbreign qui pouvaient rejoindre leur cotre au mouillage ou aller vendre leurs tacauds, pelons, lieus et maquereaux chez leurs clients à la campagne. Les marins hauturiers, sur thoniers ou chalutiers, avaient sur le porte-bagages la traditionnelle valise en osier de la godaille.
Qui se souvient que les bicyclettes ont été taxées comme les voitures il n’y a pas si longtemps avec la carte grise ? Il fallait présenter la plaque de vélo aux malins douaniers qui se postaient en général en haut de la rude côte de Beg Keroul, faute de plaque et c’était une amende !

Les piétons, journaliers, élèves des écoles et clients des commerces n’avaient d’autre solution que de marcher, la plupart en sabots de bois (boutou coat), production de Jules Boutour (Julien Le Dé) dans sa hutte à l’ancienne, vieille route de Concarneau, en face de chez Tense Rioual à l’arrière du manoir notarial. Les sabotiers étaient assez nombreux, si j’en crois les tables décennales qui indiquent les professions, les aides étaient aussi catalogués comme sabotiers. Les sabots de ceux qui marchaient beaucoup étaient cloutés pour ralentir l’usure, ça faisait du bruit dans le bourg ; avec le temps, le caoutchouc remplacera les clous. Ceux qui le voulaient pouvaient éviter la dépense des clous, mais les sabots s’usaient plus vite. Les mêmes, par le même souci d’économie, les fourraient simplement de paille, remplacée bientôt par des chaussons de laine tricotés. Les jeunes du bourg frimaient avec leurs socques, chaussures à dessus cuir et semelles de bois, gros progrès, ou encore leurs galoches, grand luxe, des chaussures montantes en cuir, toujours à semelles de bois, spécialité des galochiers de Rosporden. À l’école, nous jouions à la balle dans la cour, en galoches ou en sabots, parfois ceux-ci étaient responsables de nez cassés. Il fallait quitter les sabots ou les galoches à l’entrée de la classe.

Les lavandières descendaient la rue de Concarneau, la brouette chargée de la lessiveuse, du bois pour la chauffer, du baquet pour s’agenouiller, du linge sale, du savon de Marseille et du bleu pour le blanchir. Elles allaient d’ar ster à Kersaux, sur le petit ruisseau de Kerangallou, puis sur le lavoir construit en dur en 1934 par le célèbre Jos Caradec. Pour elles, ster, signifiait aussi bien le ruisseau que le nouveau lavoir. Au retour, il fallait pousser la brouette sur la vieille route avec le paquet alourdi de linge humide qu‘on faisait sécher devant la maison sur un fil tendu entre deux piquets.