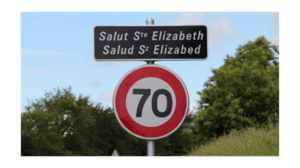Croix de chemin et autres à Trégunc

Dans l’antiquité, la crucifixion est un châtiment cruel et déshonorant réservé aux criminels, durant cette période les premiers chrétiens sont morts, crucifiés en grand nombre. La croix, symbole de souffrance et de torture, rappelant la mort du Christ, n’est utilisée qu’à partir du IV e siècle. De nombreuses croix ont été érigées sur la commune de Trégunc à partir du Moyen-Âge, il en reste aujourd’hui une douzaine.
À l’origine du christianisme, notamment durant les persécutions, les chrétiens utilisent le symbole du poisson, sorte de code secret, pour se reconnaître entre eux sans attirer l’attention. En grec le mot poisson donne ichtus, acrostiche de Iéssous Christos Théou Uios Sotèr, c’est-à-dire Jésus Christ de Dieu le Fils Sauveur.
Au IV e siècle, la croix adoptée par l’empereur romain Constantin devient emblème et symbole chrétiens.

Les premières croix

Les premières croix taillées dans le granit apparaîtraient en Bretagne vers le IX e siècle. À partir du XI e siècle, elles sont positionnées à l’entrée des villages, aux carrefours, sur les places et dans les cimetières, elles témoignent de l’avancée du christianisme qui s’affirme à côté des lieux de cultes plus anciens, avant de les intégrer bien plus tard.
De nombreux menhirs ou monuments protohistoriques servant de repères ou de limites sont christianisés. Le menhir de Kerangallou a ainsi vu une croix installée à son sommet. Il en est de même pour la stèle de Kernallec ou encore celle de Kerlogoden (déplacée avenue de la gare à Concarneau vers 1920).
Le symbole chrétien a coiffé certaines grosses pierres légendaires, comme Men Dogan à Trégunc sur laquelle une croix était scellée jusqu’en 1885. Chaque site important a fait l’objet d’une christianisation ; c’est une forme de récupération des anciens objets ou lieux de culte, telles les fontaines ou les stèles, pour en modifier la destination.
À partir du XIII e siècle, les croix constituent un élément banal du paysage et leur expansion se poursuit jusqu’à la Révolution durant laquelle de nombreux symboles du christianisme sont détruits. Le XIX e siècle est marqué par le retour des pratiques religieuses, la restauration de certaines croix et l’élévation de nouvelles.
En 1840, le préfet du Finistère demande aux maires du département de relever les croix détruites lors de la Révolution.

Les croix de chemin ou de limites
Trégunc aurait possédé une trentaine ou une quarantaine de croix situées très souvent aux carrefours, lieux de mystère qu’il faut protéger des brigandages et des rencontres maléfiques, ce sont de vieilles croyances païennes. À l’approche de la croix, on se signe furtivement pour s’assurer une protection. Les croix servent également de repères sur les voies les plus fréquentées, montrent le chemin vers le lieu de culte (église) et préparent le voyageur à y accéder, certaines croix marquent les limites du village, de la paroisse ou de la propriété ecclésiastique.
Les croix du Moyen-Âge sont en granit monolithe, parfois grossièrement taillées et plantées directement dans une roche ou installées sur un monument sommaire.
A partir des XVI e et XVII e siècles, les artisans tailleurs de pierre réalisent des croix plus grandes et plus travaillées, parfois en pierre de Kersanton, plus facile à sculpter et résistant mieux aux intempéries ; ces croix sont placées sur un soubassement ou un emmarchement composé de plusieurs degrés.
A partir du XVII e siècle, les missions se multiplient et sont l’occasion d’ériger une croix dite “croix de mission”.
Jusqu’au milieu du XX e siècle, certaines croix sont les lieux de destination des processions ou des rogations durant lesquelles le prêtre bénit les prés et les semailles pour garantir de bonnes récoltes. Selon Arthur Le Beux, la première rogation allait jusqu’à la chapelle de Kerven, la deuxième jusqu’à la chapelle de Sainte-Élisabeth et la troisième faisait deux ou trois fois le tour de l’église.
Lors des funérailles, sur le chemin menant à l’église, les convois mortuaires s’arrêtent à proximité des croix pour faire une pause et pour prier. Le baiser des croix constitue un rite funéraire, la croix qui précède le corbillard salue la croix au bord du chemin.





Les autres croix
Les croix votives sont dressées en remerciement d’un vœu accompli. Les croix de peste ornées de bubons sont dressées pour invoquer les forces divines et obtenir la cessation du fléau ou encore en signe de remerciement de la part des habitants qui ont échappé à l’épidémie. Parfois simple incision dans les mégalithes, certaines croix indiquent des endroits où se sont produits des événements marquants, heureux ou malheureux, elles sanctifient des lieux maudits.

La croix de Kerlary est dressée sur un socle volumineux surmonté d’un soubassement à trois degrés comportant à deux endroits la date gravée de 1662. Ce soubassement est lui-même surmonté d’un socle cubique pourvu d’un large larmier et portant la croix. Les nodosités ou écots sur le fût de la croix monolithe de Kerlary pourraient indiquer qu’elle a été érigée à une époque (XVII e siècle) durant laquelle sévissaient de nombreuses épidémies, notamment de peste.
Un calice est gravé à la croisée des branches. En 1963, cette croix a été restaurée par les scouts, elle menaçait de s’écrouler et le soubassement était envahi de broussailles. Avant le remembrement des années 1960, elle se situait au carrefour des routes de Grignallou au bourg et de Kerbiquet au Minaouët.
Autrefois signalée par un panneau touristique, la croix monolithe de sept mètres de haut du XVIe siècle se dressait sur le placître de la chapelle de Saint-Philibert ; elle a été déplacée dans le cimetière lors de la création de celui-ci en 1949.
Rue Tachenn Pontig, dans les années 1950, une croix est découverte à terre lors de travaux de terrassement dans la propriété de Louis Sellin. Sur les matrices cadastrales de 1845, deux parcelles portent le nom évocateur de Coat Pin an groëz et Park an groëz. Ces deux parcelles se trouvaient à gauche dans la montée vers le bourg.


On retrouve une marque identique sur une cheminée de la maison de Kerambourg.
Croix ou calvaire
Croix et calvaires sont l’expression de la foi profonde des Bretons jusqu’à une période pas si lointaine. Le calvaire représente la scène de la Crucifixion (les trois personnages présents sur le Golgotha par exemple) et parfois d’autres scènes de la passion de la vie du Christ ; c’est le cas du calvaire situé à proximité de l’église de Nizon. La croix, évocation symbolique de la croix de Jésus-Christ, est une pierre taillée monolithe portant ou non un Christ. À Trégunc, il n’y a donc pas de calvaire.
Disparition de certaines croix
A Trégunc, de nombreuses croix subsistent encore au bord des routes, mais bien plus nombreuses sont celles qui ont disparu ; le plan du cadastre napoléonien de 1845 situe quelques croix qu’on ne trouve plus aujourd’hui. Les états de sections cadastrales de la même époque indiquent le nom des parcelles et certains toponymes peuvent faire penser à la présence d’une croix dans le voisinage.
Arthur Le Beux rapporte cette croix cassée à proximité de Pendruc pour empierrer un chemin. De nos jours ces anciennes croix de granit affrontent les intempéries qui les érodent peu à peu.


Sources
- https://societe-archeologique.du-finistere.org/croix/ : l’inventaire des croix et calvaires du département du Finistère a été réalisé par Y.-P. Castel en 1980 et publié par la Société Archéologique du Finistère sous le titre “Atlas des croix et calvaires du Finistère”. L’adaptation WEB a été réalisée par Y. Autret en 1998.
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_chemin
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_carrefour
- http://cantalcroix.free.fr/pages%20html/role.htm
- http://www.persee.fr/
- Martin Hervé, Martin Louis, Croix rurales et sacralisation de l’espace. Le cas de la Bretagne au Moyen-Âge. In : Archives de sciences sociales des religions. N. 43/1, 1977. pp. 23-38.
- Les notes d’Arthur Le Beux (archives diocésaines)